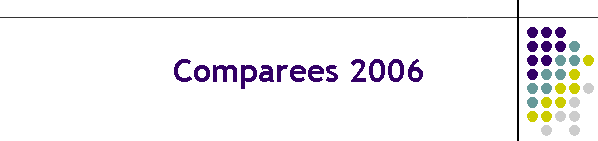
|
|
|
♦ Mois de Janvier-Février ♦ Premier mouvement du concerto brandebourgeois n°2 de Johann Sebastian Bach. Leonhardt et co Academy of ancient music The English Concert Musica Antiqua Koln Il Giardino Armonico Pourquoi le premier mouvement du 2nd concerto? C'est, musicalement, un concerto très exigeant (bien plus que le 3eme, le 4eme ou le 5eme par exemple) ; l'équilibre des différentes parties est la principale difficulté dans ce mouvement, une flûte à bec à la puissance sonore très limitée est soliste en même temps qu'une trompette au volume sonore très important. Il faut savoir faire cohabiter tous les instruments et pouvoir les distinguer sans difficultés. Bach utilise toutes les ressources de chaque instrument et demande une excellente technique aux musiciens, il n'hésite pas à utiliser les extrêmes aigues de la flûte par exemple. Il y a plusieurs thèmes qui reviennent pour un instrument différent à chaque fois. Aux interprètes de les montrer à l'auditeur. Pourquoi le choix de ces interprètes? Les Brandebourgeois font partis des oeuvres qui comptent une très importante discographie. Je n'ai sélectionné que des interprétations sur instruments anciens car rares sont celles sur instruments modernes qui utilisent une flûte à bec (exigée par Bach ; pour une fois qu'il écrit pour elle!) et un clavecin. De plus, les différences flagrantes entre une trompette baroque et moderne ne permettent pas de croire une interprétation moderne fidèle à l'idée de Bach. Le choix de la version Leonhardt&Brüggen&Kuijkens pionnière qui garde une valeur de recherche, d'envie d'authenticité s'imposait par le casting mémorable qu'elle nous donne à écouter. Celle de MAK est reconnue par bien des critiques comme la meilleure à ce jour, jugeons en! Celle d'IGA pour son coté italien, et pour ces interprètes souvent déjantés. Celle d'TEC à longtemps fait référence et celle de l'AAM à un côté intéressant pour cette comparaison... La vitesse a évolué et augmenté au fil du temps, le tempo de la version Leonhardt se situant autour de 90 (pulsations par minutes), celui de l'AAM et du TEC autour de 100 et celui de MAK et IGA vers 120. Une vitesse importante peut cacher certaines subtilités de la partition mais rend surtout l'oeuvre plus vivante, plus dense en résumé plus intense. On remarquera que seul Goebel fait un réel ralenti sur la fin de la phrase avant d'entamer le da capo (que l'on n'entend pas ici). C'est aussi lui qui fait le meilleur traitement du tissu orchestral des cordes, plus présent certes mais plus définit, plus clair. Concernant les instrumentistes Frans Brüggen est celui qui possède la plus belle articulation (écouter le solo à la 40eme seconde) par rapport à ses successeurs. Le trompette de l'interprétation d'IGA est la plus propre (n'accrochant pas sur chaque note comme les autres) mais pas la plus brillante (et en cela cette interprétation semble assez pâle, un peu lointaine, plus du à la prise de son qu'aux instrumentistes il me semble). Dans l'équilibre des parties TEC fait figure de référence dans cette écoute comparée, aucune peine pour entendre la flûte à bec derrière la trompette et ce tout au long du concerto. Le hautbois le plus subtile revient à l'instrumentiste de Musica antiqua Koln.
♦ Mois de Mars ♦ Trois variations de la Follia de Marin Marais: Jordi Savall Paolo Pandolfo Sophie Watillon La réalisation de la basse continue est comme toujours dans la musique baroque laissait au bon goût des interprètes. Et dans ce domaine, l'équipe réunie par Pandolfo apparaît comme la plus efficace et la plus claire. Clavecin brillant et présent ce qu'il faut, guitare baroque qui apporte une touche dynamique supplémentaire sans freiner la mélodie avec ses accords. Le clavecin de Behringer (chez Savall) semble reléguer au lointain et le luth semble un peu à la peine. Le clavecin, chez Watillon, est un peu fluet et la guitare a de jolis accents et l'aspect un peu bourain est convaincant. La viole de Savall, comparée aux autres, est la moins flatteuse au niveau des sonorités, elle est rêche d'authenticité! La plus élégante revenant, sans doute, à Pandoflo et la plus énergique à Watillon qui est une vraie "mitraillette". Dans la seconde variation (présentée ici), Pandolfo joue sur les contrastes (de couleurs et de nuances), Watillon fait des entrées musicales qui font l'effet d'un immense crescendo qui explose dans la variation suivante. Dans la dernière variation, Savall paraît lent et trop appuyé, ce qui coupe un peu l'énergie.
♦ Mois d'Avril ♦ Quando Corpus Morietur extrait du Stabat Mater de Pergolèse Jacobs Hennig Bonney Scholl Schiavo D'Oustrac Il m'a semblé intéressant de proposer à l'écoute des versions qui font des choix différents dans le première phase de l'interprétation, le choix des chanteurs. La version, relativement ancienne, du Concerto Vocale, comprend un contre-ténor et un soprano garçon. Celle des Talens lyriques fait le choix (de plus en plus répandu) d'un contre-ténor et d'une soprano tandis que Antonio Florio a préféré deux femmes, à savoir une soprano et une mezzo. Celui-ci adopte le tempo le plus lent, les deux autres versions sont un poil plus rapides. L'orchestre le plus léger est celui du Concerto Vocale, à un instrument partie, il n'est cependant pas le plus charmeur et l'orgue en basse continue n'est pas vraiment discret. La meilleur réalisation orchestrale revient à la capella de Turchini. Les Talens lyriques affichent une jolie profondeur. Les timbres des deux chanteurs de cette version ne se fondent pas vraiment l'un dans l'autre même si ils sont les plus purs (même si Bonney nous fait part d'un vibrato constant et non seulement sur les fins de phrases) et les plus ronds. Cette synthèse échappe également au Concerto Vocale, elle est magnifiquement réussie par l'équipe d'Antonio Florio. Le tempo de cette version semble permettre un recueillement le plus total mais il peut, d'un autre côté épuiser la continuité de la phrase en prolongeant indéfiniment le temps. La réalisation mélodique la plus efficace semble venir des Talens Lyriques.
♦ Mois de Mai ♦ Largo du concerto en ré majeur pour luth d'Antonio Vivaldi Scimone et Orlandi Lislevand IGA et Pianca La version de Claudio Scimone et de Ugo Orlandi est légendaire. Tout amateur de mandoline se doit de compter ce disque dans sa discothèque. Seuls, ils font le choix d'une mandoline, les autres lui préfèrent le luth. Ce choix permet plus de couleurs, il permet une luminosité sans pareille. Une sérénité et une plénitude miraculeuses règnent dans cet enregistrement. Même si l'orchestre est plus touffu et la basse continue plus conventionnelle on observe une fusion parfaite avec le soliste. Dans la première partie (l'extrait est un montage et ne comprend pas le reprise de cette partie et passe directement à la seconde partie en mineur) Rolf Lislevand improvise librement et apporte une touche originale, une couleur méridionale. La basse continue faite au luth et à la guitare baroque peut sembler redondante par rapport au soliste. Les cordes sont toutefois magnifiques. Le luth de Luca Pianca est plus puissant et à une présence plus affirmée ce qui lui permet de mieux se détacher. Les violons sont plus présents et moins subtils qu'avec Lislevand. Le clavecin également. La couleur est plus brillante, moins feutrée. Celle de Lislevand, matte, apporte un calme plus charmeur à l'oreille.
♦ Mois de Juin ♦ Concerto en sol mineur pour cordes et basse continue de Arcangelo Corelli The English Concert Pinnock La Petite Bande Kuijken Europa Galante Biondi Il s'agit de montage entre plusieurs mouvements. L'ouverture est ample et posée avec de belles basses chez Pinnock, rapide, nerveuse et seche voire étriquée chez Biondi ; lente et large chez Kuijken. La fugue qui suit est dynamique, élancée, vive, bien plus lente chez Kuijken avec des violons aux sonorités plus ingrates, l'effectif semblant plus réduit. Elle prend l'allure d'un concerto de chambre chez Biondi avec une basse continue bien présente. Le mouvement qui suit est jouée en crescendo géneral chez Pinnock avec un tempo plus allant que chez Kuijken qui impose lui un très léger crescendo. Biondi le concoit avec des accents rythmés, et une fin très douce. Le mouvement lent et langoureux constitue une partie à orner pour Biondi.
♦ Mois de Juillet-Août♦ "Remenber me", air de Didon, extrait de Didon&Enée de Purcell Guillemette Laurens Anne-Sophie von Otter Catherine Bott Susan Graham Le tissu orchestral tissé par Christie pour Laurens est sans opulence aucune, sobre, simple et recueilli. Il laisse la chanteuse s'épanouir petit à petit même si peu de contrastes sont remarquables. Un tempo un peu plus rapide anime l'idée de l'oeuvre chez Pinnock. Une voix plus lyrique, avec un vibrato élégant pour Von Otter. Joli crescendo orchestral et vocal. Même vitesse chez Hogwood avec l'ajout d'un luth pour assurer la basse continue, petite voix étroite de Bott avec un timbre plus nasal. Très beaux aigus cependant. Vibrato permanent pour Graham avec la voix la plus fruitée, elle roule les "r" sur les "remember" ce qui est du plus bel effet. Orchestre le plus présent de la comparaison, le Concert d'Astrée n'a pourtant pas le plus beau son, trop disparate.
♦ Mois de Septembre-Octobre♦ Allegro non Molto, premier mouvement de l'Hiver, issu des Quatre Saisons de Vivaldi. Simon Standage Fabio Biondi 1 Giuliano Carmignola 1 Enrico Onofri Fabio Biondi 2 Giuliano Carmignola 2 Duilio Galfetti Le choix des versions: J'ai uniquement sélectionné des versions sur instruments dits anciens. Je ne peux pas mettre plus de versions en comparaisons et pourtant des versions sur instruments modernes avaient largement leur place. Ainsi, Felix Ayo et I Musici, Janine Jansen (superbe version toute récente), ou même encore Nigel Kennedy dans une autre approche ont bien des mérites que je ne peux malheureusement pas exposer. Alice Harnoncourt et le Concentus Musicus Wien aurait aussi eu beaucoup à dire. Le choix du mouvement: Le premier mouvement de l'Hiver est particulièrement propice à de multiples sources d'inspirations et d'exécutions. De plus, ce choix permet de comparer l'orchestre dans son jeu d'ensemble, le soliste ainsi que l'opposition orchestre/soliste. Deux grands violonistes baroques ont réenregistré les Quatre Saisons alors qu'ils avaient tous les deux signés des versions historiques. Standage et Pinncok se détachent sur un point essentiel du disque: la prise de son est miraculeuse (en mp3 il est plus difficile d'en juger). Le son est très soigné, transparent et propre, contrairement à Il Giardino Armonico ou I Barrochisti. Un des tempos les plus rapides, il faut remarquer que Biondi, pourtant grand agitateur par ailleurs, choisit un tempo ample et allant mais sans rapidité. C'est une version dans la lignée "traditionnelle" de 'l'interprétation, sans effets, ni coups d'archets extraordinaires. Uniquement le texte sans extrapolation, l'hiver est sans doute suffisamment décrit comme cela. Très beaux tuttis. Violon clair, net et précis. Chez Biondi I, introduction d'accords au clavecin dans la montée en crescendo vers le solo de violon. Violon qui explose littéralement en début et fin de phrase de l'appel initial. Son plus mat et moins solaire que chez Pinnock. Biondi ose un fort vibrato dans la fin des phrases tenues de la seconde partie de l'extrait (après le tutti). Dans sa seconde version le rôle du clavecin est renforcé dans la montée, lui conférant le rôle de soliste, crescendo encore plus marqué, tout comme les explosions. Globalement Biondi reprend les mêmes idées mais en les poussant encore plus à l'extrême. Prise de son plus proche. L'esthétique de Carmignola I est à rapprocher de Standage et Pinnock, peu d'effets et préférence au beau son. Clavecin bien défini et présent qui assure une grosse basse continue. Montée initiale uniquement aux cordes et à une bonne vitesse! Pas mal de réverbération dans la prise de son. Dans sa seconde version, les cordes I et II sont nettement séparées et spatialisées. La phrase solo est lancée sur note franchement appuyée avant de finir sur un gros trille large et puissant. Tuttis élégants et sans effets. Ajouts d'appogiatures à l'endroit même où Biondi fait un effet de vibrato. Les amateurs d'effets se régaleront de la version toujours décapente d'Il Giardino Armonico. N'a-t-on jamais entendu un hiver aussi démonstratif. Les effets font réellement croire aux branches d'arbre qui cassent sous le poids de la neige, sous le gel, au vent qui les parcourt. Les dents claquent et grincent bel et bien. Tuttis secs et tendus. Son du violoniste pas franchement joli et ample. Dans le même esprit mais dans un tempo plus rapide, I Barocchisti est amateur d'effets démonstratifs notamment dans la montée. Jeu solo au tempo variable. Tuttis endiablés. Jeu solo avec beaucoup d'effets.
♦ Mois de Novembre♦ Tu devicto mortis aculeo, extrait du Te Deum H146. de Marc-Antoine Charpentier William Christie Marc Minkowski Martin Gester Jean Tubery Entre les différentes sections de ce morceau chaque chef y va de son silence plus ou moins long. Minkowski inscrit sa démarche dans une urgence parfaitement maîtrise et ne prend guère le temps d'aérer le texte. Il ne s'appuie pas comme les autres chefs sur le passage du choeur qui harmoniquement contraste avec la tonalité de l'oeuvre (de 33' à 43'). Il peut compter sur les trompettes plus percutantes et nettes de la comparaison. Equilibre orchestral (violons, vents) très bien pensé dans l'optique un poil guerrière de cette oeuvre. A son opposé, Martin Gester privilégie le choeur et accentue, en ralentissant beaucoup notamment, le passage suscité. C'est une conception beaucoup plus phrasé et legato de l'oeuvre. On entend relativement peu les violons. Ce qui est aussi le cas dans la version de Tubery qui dispose d'un éventail de vents plus fourni mais forcement net. Le choeur a des couleurs très marquées entre les différents pupitres. Cet enregistrement ne bénéfice malheureusement pas d'une prise de son assez rapprochée de sorte qu'un son cathédrale réverbéré gâche un peu l'écoute. Le précurseur Christie nous gratifie d'un équilibre orchestral agréable mais pas des plus mordants. Un son caractéristique comme toujours avec les Arts Florissants dans la musique française. Christie est le chef qui respecte le mieux les différentes sections de l'oeuvre et sans trop appuyé (comme chez Gester) met bien en valeur la particularité de la partie centrale. ♦ Mois de Décembre♦ Les Trois Mains, pièce de clavecin, par Jean-Philippe Rameau. William Christie Noëlle Spieth Christophe Rousset Blandine Rannou Commençons par le choix du clavecin. Celui de William Christie (WC) apparaît bien aigre et démodé. Les copies n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Celui De Noëlle Spieth (NS) est le plus racé. Un son caractéristique ave beaucoup de caractère et de puissance. A côté celui de Blandine Rannou (BR) semble bien gentillet et maigrichon. Peut-être le plus adapté à la musique de Rameau est-ce celui de Christophe Rousset (CR)? Une véritable synthèse entre la douceur et la puissance. Dans le caractère, WC hache un peu le trait de sorte à rendre cette musique sautillante, à l'italienne. Un peu hors propos peut-être. CR adopte un tempo sensiblement plus rapide. Et ne s'attarde sur rien, point de rubato. Un jeu ferme et tendu de bout en bout, sans véritable respiration. Une basse continuellement présente et soutenue (la troisième main). BR a un jeu très ramassé, sans grande amplitude; on se perd un peu dans ses trilles trop touffus et non distanciés. Un poil de vigueur n'aurait pas fait de mal: les basses ont tendance à s'écraser. NS a un jeu alerte sans brusquerie et nous émerveille par la netteté de ses trilles parfaitement enchaînés. Des basses vives et qui fournissent en même temps une parfaite assise pour la mélodie. Elle retarde la descente finale pour faire une fin un peu théâtrale ce qui est tout à fait dans l'esprit de Rameau.
Site optimisé pour Mozilla Firefox avec une résolution de 1024*768. R.Gibert 2006.
|